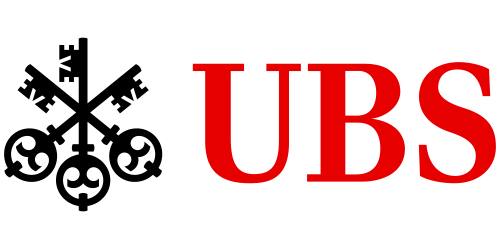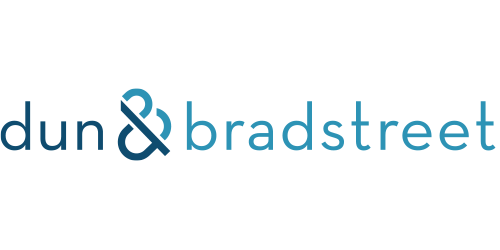Comment la Chine négocie avec le monde
Au cours des 40 dernières années, la Chine a réussi à se positionner intelligemment sur la scène internationale, tant sur le plan politique qu’économique, grâce à son propre dynamisme national et international.
L’une des clés de ce succès réside dans le concept stratégique de « constellation design » (Zaoshi). Ce concept puise son origine dans la philosophie du yin et du yang et s’inspire des stratagèmes chinois. Contrairement à la négociation et à la pensée stratégique occidentales, cette approche ne vise pas à pratiquer le jeu de la négociation de la meilleure façon possible. Elle mise plutôt sur l’élaboration des négociations et des règles, de manière à obtenir la solution la plus optimale, indépendamment du comportement de l’adversaire.
Dans la culture occidentale, le jeu d’échecs symbolise la forme la plus aboutie de la pensée stratégique. Nous respectons les règles et leurs origines sans les remettre en question. Le Zaoshi chinois se montre plus ambitieux et plus prometteur, dans la mesure où il façonne à la fois le champ d’action et les règles du jeu. Cette stratégie est plus créative et multidimensionnelle, ce qui la rend particulièrement adaptée à l’environnement géopolitique et économique complexe actuel. Le concept global VUCA tente d’exprimer cela. L’environnement économique, politique et social devient de plus en plus rapide (Volatility), incertain (Uncertainty), complexe (Complexity) et ambigu (Ambiguity). Dans ce contexte, les stratégies et les négociations monocausales et rationalistes ne fonctionnent plus. C’est là qu’entrent en jeu les constellations, qui consistent à influencer activement l’environnement, les circonstances et le cadre. C’est ce que nous percevons en Occident comme de la sophistication et de l’ingéniosité. Dans le contexte chinois en revanche, cela fait partie intégrante de la stratégie.
La Chine exprime ce principe régulièrement dans ses ambitions politiques mondiales. Pékin y parvient notamment à travers le concept, quelque peu opaque, des « BRICS ». Souvent méconnus, les BRICS font pourtant l’objet de nombreux reportages médiatiques et sont perçus comme la nouvelle voix mondiale du Sud. En réalité, le dispositif des BRICS ne correspond pas à une organisation internationale. Les États BRICS ne disposent ni d’un secrétariat permanent ni d’une charte. Néanmoins, ce conglomérat exerce un fort attrait et devient de plus en plus le symbole et le lieu d’une nouvelle multipolarité politique mondiale. Les notions ami, ennemi et concurrent s’estompent. L’objectif commun à long terme – représenter une alternative au Nord – maintient l’unité des pays. Parallèlement, des facteurs tels que les infrastructures et la domination technologique créent des dépendances. Ces pays se rapprochent de plus en plus, entretenant des relations très étroitement imbriquées. Cela, avec des options toujours différentes quant à la manière dont les choses pourraient évoluer. Dans de telles constellations, tout le monde n’est pas obligé de partager systématiquement le même avis ; certains États peuvent collaborer dans certaines situations et pas dans d’autres. Cela leur permet de naviguer avec agilité et de réagir aux événements et développements imprévisibles, sans perdre de vue l’objectif stratégique.
C’est pourquoi la Chine a jusqu’à présent réussi, avec habileté et sans trop de dommage, à gérer la présidence Trump. Elle s’y était préparée. Elle peut, selon la situation, utiliser tous les outils de projection de puissance géopolitique, infrastructurelle et économique. Le Sud global trouve en la Chine un partenaire ouvert, bienveillant et fiable, tandis que les Etats-Unis sont perçus comme dominants et instables. Cette compétition est donc également une guerre de discours. Cependant, ces derniers sont étayés par des faits s’appuyant sur les infrastructures, les investissements et les dépendances correspondantes. Dans cette optique, l’objectif stratégique prime sur la victoire tactique. Les revers sont perçus comme de nouvelles opportunités et en cas de doute, réinterprétés et présentés dans un nouveau contexte. Il s’agit donc aussi d’un plaidoyer contre l’absence d’alternatives et, à cet égard, rappelle fortement le milieu de nos start-up et de l’innovation.
L’art de la négociation ne réside donc pas dans la négociation elle-même, mais dans la définition du cadre. Alors que la pensée occidentale est très linéaire, la pensée chinoise s’articule autour d’un problème. Des méthodes conventionnelles et non conventionnelles sont utilisées de manière égale. Cette approche est à la fois active et attentiste. Elle exige créativité, minutie, prudence et attention. Elle est à la fois communicative et opérationnelle. Le calme et la prudence dans cette approche, sont aux antipodes de l’agitation et de la fébrilité occidentales.
Cette stratégie de négociation par constellations est également hautement interdisciplinaire. Les Chinois exploitent autant que possible l’ensemble du spectre politique mondial. L’armée, la diplomatie, les infrastructures et l’économie ne sont que quelques vecteurs parmi d’autres. À cela s’ajoutent des éléments tels que la culture, l’environnement, les médias et le droit, qui peuvent également servir à projeter leur puissance. C’est une façon de penser en termes d’options. La liberté d’action est donc une mentalité. Le maître-mot est la résilience.
Considérer la résilience comme un élan stratégique et surtout créer des architectures de résilience à moyen et long terme au sein des gouvernements et des entreprises, dans lesquelles les règles du jeu sont définies « en passant » et presque inaperçues. Tels sont les nouveaux vecteurs de la politique de négociation internationale.